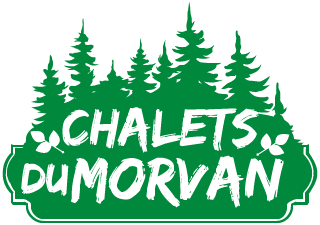Le Morvan, région de moyenne montagne en Bourgogne, fut entre le XIXe et le début du XXe siècle une véritable terre de lait, à la fois lieu d’accueil pour des milliers d’enfants abandonnés et terre d’origine de nombreuses nourrices parties allaiter à Paris. À travers les portraits de deux figures emblématiques, Marie Joly, nourrice du comte hongrois Tivadar Andrássy, et Jean Genet, écrivain célèbre ayant été pupille dans le Morvan, le texte retrace cette histoire humaine et sociale.
Dès le début du XIXe siècle, des enfants orphelins ou abandonnés, appelés les « petits Paris », étaient envoyés de l’Assistance publique de Paris vers des familles nourricières du Morvan. Emmanuelle Jouet, chercheuse, estime qu’environ 250 000 enfants ont été placés dans la région entre 1820 et 1950. Les nourrices morvandelles, issues de familles pauvres, recevaient une pension pour accueillir ces enfants jusqu’à l’âge de 13 ans, âge correspondant à la fin de la scolarité obligatoire. Certains, comme Genet, poursuivaient leur formation dans des écoles professionnelles ; la majorité devenait une main-d’œuvre agricole.
Ces enfants portaient un collier avec un numéro de matricule et une médaille de Saint-Vincent-de-Paul. S’ils ont parfois trouvé affection et stabilité dans ces familles, nombreux sont les témoignages évoquant aussi la dureté de l’accueil, motivé avant tout par des considérations économiques.
Parallèlement, le Morvan envoyait chaque année des centaines de nourrices vers les grandes villes, notamment Paris. Issues de milieux modestes, ces femmes étaient recrutées pour allaiter les bébés des familles riches — parfois même royales — dans les quartiers aisés. On distinguait les « nourrices sur lieu », employées directement dans les maisons bourgeoises, des « nourrices sur place » restées dans le Morvan. Ces femmes gagnaient bien leur vie et envoyaient régulièrement de l’argent chez elles, permettant la construction de maisons appelées « maisons de lait », symboles visibles de cette activité. Mais leur engagement n’était pas sans drame : certaines laissaient leurs propres enfants derrière elles, parfois décédés en leur absence.
La mémoire de cette époque, entre solidarité et exploitation, est aujourd’hui préservée à travers divers projets culturels, notamment la création d’un musée à Alligny-en-Morvan dédié aux enfants de l’Assistance publique et aux nourrices. Des expositions, témoignages, pièces de théâtre et conférences contribuent à restituer la complexité de cette histoire.
Des récits poignants, comme celui de Lucienne et Marc, deux anciens pupilles ayant grandi dans le Morvan, montrent à la fois la tendresse de certains foyers et le rejet social que ces enfants pouvaient subir. D’autres documents, comme les carnets de Mathieu Tamet, inspecteur des familles nourricières, révèlent la variété des situations, allant de l’attention bienveillante à la maltraitance, comme dans le tristement célèbre procès des Vermireaux en 1910, où furent jugés des cas graves d’abus dans une institution pour enfants.
En définitive, cette histoire collective du Morvan témoigne d’une rencontre entre deux vulnérabilités : celle des enfants abandonnés et celle de femmes pauvres cherchant à survivre, réunies par un système aussi nourricier qu’ambivalent.