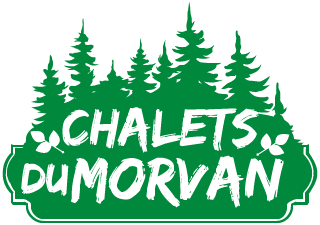Cet été, « Les Echos » vous proposent de rencontrer ceux et celles qui œuvrent en coulisses pour rendre la forêt durable. Troisième étape de ce voyage, un laboratoire forestier qui, pour lutter contre le dépérissement qui touche les épicéas du Morvan, a arraché soixante hectares d’arbres en mauvaise santé pour y replanter vingt nouvelles essences. Un premier pas pour expérimenter de nouvelles pratiques sylvicoles.
Au cœur du massif du Morvan et perché à 821 mètres d’altitude, le Mont Beuvray (Saône-et-Loire) est un ancien oppidum gaulois connu pour ses ruines bien préservées et son point de vue imprenable sur le parc naturel régional. Mais depuis 2022, le paysage a drastiquement changé : au milieu des monocultures qui peuplent la forêt morvandelle, une parcelle d’une soixantaine d’hectares a été complètement repensée. Auparavant constituée à 100 % d’épicéas (résineux), une essence touchée de plein fouet par le dépérissement, cette forêt accueille désormais une vingtaine d’essences différentes, et a vocation à expérimenter de nouvelles pratiques sylvicoles plus durables, tout en recueillant des données scientifiques cruciales.
On doit cette initiative au laboratoire forestier du Grand Site de France « Bibracte Morvan des Sommets », en partenariat avec les deux propriétaires du massif forestier de Bibracte : l’Etat et le parc naturel régional (PNR) du Morvan. « Les épicéas sont en dépérissement depuis 2016 à cause des épisodes de sécheresses qui s’accentuent », explique Jean Cacot, chargé de mission au laboratoire forestier. Pourquoi l’épicéa plus qu’une autre essence ? « Il a été largement utilisé pour du reboisement, notamment après la seconde guerre mondiale, mais étant une essence de montagne, elle était déjà en situation de vulnérabilité », restitue Mathieu Mirabel, responsable du département de la santé de forêts en Bourgogne-Franche-Comté.
Ce phénomène touche tout le Morvan et est visible pour chaque randonneur amateur. « L’arbre a besoin de transpirer mais ses vaisseaux conducteurs sont coupés, ce qui empêche l’eau de passer. L’arbre rougit et il sèche sur pied », ajoute le chargé de mission, résigné à l’idée que les épicéas disparaîtront d’ici une dizaine d’années.
Des résultats visibles dans 100 ans
Le risque, c’est que d’autres essences disparaissent aussi rapidement que l’épicéa. « La forêt du Beuvray est composée à 75 % de feuillus avec une majorité de hêtres, qui souffrent aussi du réchauffement climatique. Or si l’on suit la trajectoire à +4 degrés d’ici 2100, ils courent un grand danger », développe-t-il.
Réconcilier les acteurs de la forêt
Au-delà de la pure démarche scientifique, cette expérimentation dénote par le dialogue territorial qu’elle a su impulser. Essentielles pour la captation du carbone, les forêts génèrent parfois des conflits entre les propriétaires forestiers et les militants écologistes ou les habitants. Grâce à cette démarche, le laboratoire forestier a réussi à mettre autour de la table tous les acteurs de la forêt afin de créer une dynamique commune. « Grâce à nos rencontres, nous avons obtenu des victoires, comme une meilleure gestion des chemins de randonnée (en évitant les débardages). Nous ne sommes pas là pour dicter les bonnes actions, mais donner des pistes et résultats scientifiques aux propriétaires forestiers, qui n’ont pas les fonds ni le temps pour expérimenter et se tromper », précise-t-il. Dans le Morvan, 85 % des forêts sont privées.
Pour mener ses actions, le laboratoire forestier peut compter sur un large tissu de partenaires institutionnels et scientifiques : l’Office national des forêts, le PNR du Morvan, l’Université de Bourgogne, l’université Mendel (République tchèque), l’Université d’Orléans, l’INRAe de Nancy, les réserves naturelles de France et l’Observatoire des forêts sentinelles. Le consortium a par ailleurs obtenu 600.000 euros de subventions européennes (via les fonds Feader) sur la période 2022-2026.
Article du 08/08/2025 par Lucile MEUNIER dans Les échos.