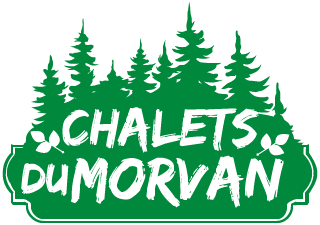Cet été, « Les Echos » vous proposent de rencontrer ceux et celles qui œuvrent en coulisses pour rendre la forêt durable. En guise d’introduction, ce premier volet décrypte les raisons des grandes fragilités des forêts de Bourgogne-Franche-Comté
Depuis une dizaine d’années, les signaux d’alertes se multiplient dans les forêts de Bourgogne-Franche-Comté. « Depuis 2018, nous connaissons une répétition de sécheresses et de fortes chaleurs chaque année, à l’exception de 2021 et 2024. Ce phénomène affecte particulièrement les épicéas, une essence ravagée par les scolytes, ces insectes dont le développement est favorisé par le réchauffement climatique », explique Mathieu Mirabel, responsable régional du département de la santé des forêts (DSF), un service technique du ministère de l’Agriculture. « Cette essence d’origine montagneuse, déjà stressée par le réchauffement du climat, est davantage attaquée par les scolytes, qui préfèrent s’attaquer aux arbres déjà affaiblis », ajoute-t-il. L’essentiel des épicéas du Morvan a déjà été « scolyté », et désormais, les attaques se déroulent plutôt dans le Jura, à plus haute altitude. Mais le hêtre n’est pas non plus épargné. Son déficit foliaire, un indicateur de stress, est en nette augmentation en Bourgogne-Franche-Comté depuis 1997, même si on observe une « stabilisation des dépérissements de hêtres depuis 2021 », selon le DSF.
Les bioagresseurs en augmentation
Si le dérèglement climatique est un catalyseur majeur des dépérissements, d’autres menaces moins connues pèsent sur ces espaces naturels, essentiels à la captation du carbone. « On connaît une explosion des attaques de bioagresseurs exotiques, à cause de la multiplication des échanges commerciaux », insiste Mathieu Mirabel.
Un des exemples les plus récents concerne la cicadelle des pins, un petit insecte qui attaque ces grands arbres, provoquant leur rougissement puis la perte de leurs aiguilles, surtout en Saône-et-Loire, en Côte-d’Or et dans le Doubs, comme l’a révélé le DSF dans une note publiée au printemps. Mais, pour l’instant, ces attaques ne génèrent pas de dépérissements.
Ce qui n’est pas le cas des assauts de la pyrale du buis, un des bioagresseurs les plus virulents, responsable du dépérissement de 80 % de cette plante en l’espace de moins de dix ans. « Cet insecte est arrivé par l’achat massif de petits buis venant d’Asie, que les particuliers mettent dans leur jardin. La pyrale est ensuite sortie des maisons pour gagner du terrain en forêt », détaille Mathieu Mirabel.
Autre exemple frappant : la charalose du frêne, détectée pour la première fois en 2008 en Haute-Saône. « Ce champignon a été introduit en France par des échanges commerciaux venant de frênes asiatiques », indique l’expert forestier. Il est responsable de forts taux de mortalité chez le frêne commun, notamment chez les jeunes arbres.
Des perspectives de très long terme
Dans ce contexte, les propriétaires forestiers ont du mal à se projeter. « Contrairement à d’autres cultures (comme la vigne), la forêt a un cycle d’une centaine d’années, donc les résultats de nos actions ne se verront pas tout de suite. Et on ne connaît pas encore très bien les caractéristiques génétiques de nos forêts », précise Mathieu Mirabel, qui explique qu’en cas de canicules extrêmes (avec des températures à 45 voire 50 degrés), des mortalités peuvent apparaître sur certains arbres en seulement quelques jours.
Toutefois, les propriétaires forestiers semblent avoir pris conscience de l’urgence de la situation. « Nous savons aujourd’hui que la diversité (des essences et de la gestion forestières) offre une plus grande résilience aux forêts. Toute la profession l’a bien en tête aujourd’hui », note le représentant du DSF.
Pourtant, les phénomènes de coupes rases persistent, en particulier dans le Morvan. Cette technique, fortement décriée, consiste à couper à blanc une parcelle entière pour y replanter de nouveaux arbres, provoquant un affaiblissement de la biodiversité.
Article du 06/08/2025 par Lucile MEUNIER paru dans Les échos.